Seth David Radwell est l’auteur de American Schism: How the Two Enlightenments Hold the Secret to Healing our Nation et siège aux comités consultatifs des organisations Business for America, RepresentUs et The Grand Bargain Project. Il est diplômé avec summa cum laude de Columbia University et titulaire d’un master de la Kennedy School of Government de Harvard.
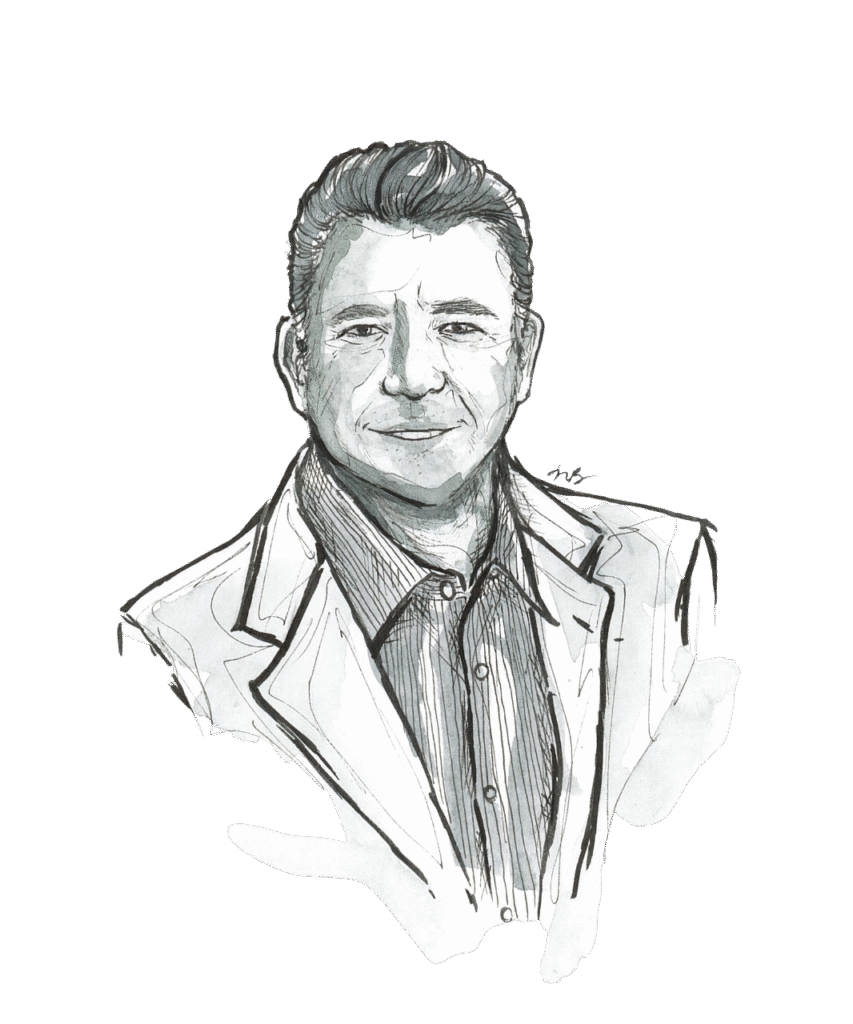
Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, nous sommes témoins, une fois de plus, d’un spectacle quotidien qui prêterait presque à sourire s’il s’agissait d’une série télévisée. L’assaut inédit et obstiné mené par le Président contre les normes et les institutions de la démocratie américaine est pourtant bien réel – et représente la menace la plus grave à laquelle notre république ait été confrontée depuis quatre-vingts ans.
Si son entreprise progressive de concentration du pouvoir et ses penchants autoritaires – dignes d’une époque que l’on croyait révolue – sont en eux-mêmes inquiétants, c’est surtout sa capacité à contrôler le récit national qui lui permet de saper, en toute impunité, le tissu même de la nation américaine. Ses actes ne menacent pas seulement la république qu’il dirige désormais : ils ébranlent l’intégralité de l’ordre mondial hérité de l’après-Seconde Guerre mondiale. Lorsqu’il affirme que les États-Unis obtiendront le Groenland « d’une manière ou d’une autre » ou que le Canada pourrait devenir le 51e État de l’Union, Trump bafoue ouvertement le principe fondamental de souveraineté inscrit dans la Charte des Nations Unies… conduisant des pays jusque-là alliés à entreprendre des mesures de protection face à une puissance désormais perçue comme un danger.
Comment en sommes-nous arrivés là ?
C’est précisément cette question que j’ai entrepris d’explorer il y a quelques années, lors du premier mandat de Donald Trump. Ce travail a abouti à la publication de American Schism, ouvrage dans lequel je soutiens que l’on ne saurait comprendre la polarisation politique américaine actuelle sans en retracer l’histoire1. Celle-ci nous ramène aux origines mêmes de la démocratie américaine, fin XVIIIe siècle.
La fracture idéologique qui ronge aujourd’hui les États-Unis s’inscrit, en effet, dans la continuité directe de ce que je nomme le premier « Schisme américain », né dès la fondation du pays. Une fois la guerre d’indépendance remportée, les Pères fondateurs se trouvèrent confrontés à une tâche redoutable : doter la jeune république d’un véritable gouvernement. Les Articles de la Confédération, alors adoptés par les treize anciennes colonies, se révélèrent rapidement inadaptés aux besoins du moment, marquant le début d’un profond désaccord sur l’organisation du pouvoir – et, avec lui, de la première grande fracture de la démocratie américaine.
Deux conceptions du pouvoir
Au moment de définir les bases de ce futur gouvernement, deux visions opposées de la gouvernance s’affrontèrent.
D’un côté, John Adams et Alexander Hamilton considéraient que la complexité de la conduite des affaires publiques nécessitait de s’appuyer sur les esprits les plus brillants du pays. Les défis pressants de l’époque – remboursement de la dette de guerre, recherche d’alliés à l’étranger – appelaient, selon eux, des réponses pragmatiques et ambitieuses, dépassant les logiques particularistes des anciens États au profit d’un pouvoir fédéral fort. Portés par une conception souvent qualifiée de « république aristocratique », les dirigeants les plus instruits du pays mirent donc leur expertise au service de solutions élaborées à l’échelle nationale, conçues pour répondre aux besoins communs de l’ensemble de la population.
Face à eux, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin et Thomas Paine défendaient un tout autre idéal : celui d’une démocratie représentative fondée sur la désignation de délégués chargés de porter la voix du peuple. Marqués par la libération récente du joug monarchique britannique, ceux-là se méfiaient profondément de toute concentration du pouvoir, privilégiant un mode de gouvernance proche des communautés locales et assorti d’un encadrement strict de l’autorité centrale. De cette mouvance naquit une méfiance tenace à l’égard des élites, dans laquelle s’enracine encore aujourd’hui la tradition populiste américaine.
La naissance des premiers partis politiques
Le conflit entre ces deux visions ne tarda pas à s’intensifier, donnant naissance aux premiers partis politiques du pays : les Fédéralistes de Hamilton d’un côté, les Démocrates-Républicains de Jefferson de l’autre. Sans l’intelligence politique et le sens du compromis de James Madison – qui sut faire le lien entre ces deux camps lors de la rédaction de la Constitution – il est probable que celle-ci n’aurait jamais été ratifiée.
Ce texte demeure aujourd’hui encore la clef de voûte du système politique américain. Mais les tensions originelles, elles, ne se sont jamais complètement dissipées. Bien au contraire : la fracture entre élitistes et populistes a traversé les siècles, resurgissant régulièrement sous des formes nouvelles au gré des crises traversées par le pays. Car au-delà des querelles partisanes, des désaccords idéologiques ou programmatiques, une question fondamentale demeure, toujours irrésolue : qui détient véritablement le pouvoir de gouverner ? À qui revient, en pratique, l’autorité évoquée par la formule fondatrice We, the people ?
L’une des grandes intuitions de Donald Trump fut de percevoir le dernier schisme bien avant les autres, il y a plus de dix ans.
L’histoire en balancier des États-Unis
L’histoire politique américaine suit un mouvement de balancier, oscillant entre deux réponses opposées à cette question. Après trois décennies de domination fédéraliste, marquées par l’installation des principales institutions fédérales, le mouvement jacksonien fit souffler sur le pays un vent nouveau de populisme2. Plus tard, à la faveur de l’industrialisation qui suivit la guerre de Sécession, les élites du Nord-Est accumulèrent des fortunes colossales durant ce que l’on a appelé l’Âge doré (Gilded Age). En réaction, un populisme d’un genre nouveau émergea à la fin du XIXe siècle : l’Alliance des fermiers (Farmers’ Alliance)3, qui s’efforça de mobiliser, d’éduquer et d’organiser les agriculteurs indépendants du Sud et de l’Ouest afin de résister à la puissance des intérêts économiques dominants. Si les succès de ce mouvement furent d’abord limités, les réformes de l’ère progressiste des années 1920 incarnèrent un nouveau basculement en faveur des forces populaires.
A la fin du XXe siècle, l’establishment américain posa les fondations d’une économie mondialisée, censée garantir la prospérité du plus grand nombre. Mais une nouvelle fois, le balancier s’est inversé : une puissante vague populiste s’emploie désormais à démanteler nombre des structures mises en place depuis la Seconde Guerre mondiale.
L’une des grandes intuitions de Donald Trump fut de percevoir cette inversion bien avant les autres, il y a plus de dix ans – et surtout d’en faire une arme redoutable dans sa conquête du pouvoir. En diabolisant les élites des côtes comme ennemies du peuple et en érigeant les classes rurales et populaires en victimes « oubliées » du système, Trump a ravivé avec force la fracture entre populistes et élitistes. Cette défiance à l’égard des institutions s’est depuis imposée comme l’un des marqueurs centraux du message politique de l’ère MAGA.
Le modèle économique mondialisé à l’origine de la fracture actuelle
Si les forces à l’origine de la fracture américaine n’ont jamais disparu, leurs manifestations, elles, n’ont cessé d’évoluer. Pour en saisir les expressions contemporaines, il faut se pencher sur les quatre dernières décennies : c’est là que la mondialisation – devenue le modèle économique dominant – s’est imposée. Or, tout modèle économique produit ses gagnants et ses perdants. Une part importante de la population du pays, bien intégrée à cette nouvelle économie mondialisée, en a largement tiré profit. Mais des millions d’Américains, vivant dans de vastes régions industrielles ou rurales, ont au contraire subi de plein fouet cette transformation, conséquence notamment de l’externalisation croissante de l’activité économique.
Ce grand écart a profondément redessiné le paysage politique américain. Pendant l’essentiel du XXe siècle, les clivages partisans étaient structurés autour de l’axe gauche-droite hérité de l’après-guerre, reposant essentiellement sur le degré d’intervention de l’État dans la sphère économique. Celui-ci s’est peu à peu estompé, supplanté par l’opposition élitistes-populistes, plus perceptible que jamais. La défiance envers les décideurs politiques a explosé du côté des Américains laissés pour compte et, pour couronner le tout, l’establishment des deux grands partis a systématiquement ignoré leurs revendications, parfois même avec une certaine condescendance. Les fractures sociales et idéologiques qui en résultent sont devenues les marqueurs profonds de ce nouveau basculement dans l’histoire politique américaine.
Un schisme au-delà de l’Amérique
Dans quelle mesure cette tension entre élites et forces populaires traverse-t-elle d’autres démocraties libérales ? Dès 2014, Christophe Guilluy en proposait une lecture lucide dans La France périphérique, ouvrage prémonitoire de la polarisation croissante de la société française consécutive à l’adoption du modèle mondialisé4. Il y décrit comment la ligne de fracture s’est progressivement dessinée entre les territoires tirant profit de l’ouverture économique, souvent urbains et connectés, et ceux en subissant les effets, relégués hors des centres de décision. L’explosion du mouvement des Gilets jaunes en est une illustration saisissante, au même titre que le Brexit au Royaume-Uni ou les récents résultats électoraux en Allemagne5.
Une analyse récente, proposée par Pippa Norris et Ronald Inglehart dans leur ouvrage Cultural Backlash, publié en 2019, met en lumière les ressorts communs à ces bouleversements des sociétés occidentales6. Malgré des contextes nationaux distincts, ils montrent que les fractures politiques et sociales obéissent à une même logique structurelle, résidant dans la résurgence d’un double mouvement : le retour de l’autoritarisme et la montée du populisme.
Aller de l’avant
L’élection présidentielle américaine de 2024 a cristallisé une colère ouvrière trop longtemps contenue. Trump, en chef de file d’un mouvement quasi religieux, a galvanisé ses troupes MAGA avec un mot d’ordre – « foutons les bâtards dehors » (throw the bastards out) – et une promesse : démanteler les institutions d’élite patiemment édifiées au fil des décennies.
S’agit-il de l’apogée de l’ère MAGA aux États-Unis ? Quelle que soit la phase du cycle dans laquelle nous nous trouvons, il ne saurait y avoir de progrès sans un regard lucide sur le passé. Car ce que révèle cette analyse, c’est que les modèles élitiste et populiste ont, chacun à leur manière, contribué à façonner notre République. À certaines périodes de notre histoire, nous avons même su trouver une « formule magique » conciliant ces visions antagonistes pour dégager une voie médiane plus féconde.
Quels en étaient les ingrédients ? Comment avons-nous su mobiliser l’expertise des élites pour relever les défis complexes, tout en permettant aux forces égalitaires d’en tempérer les excès ? Hélas, dans le climat actuel, il semble que nous ayons renoncé à toute lecture raisonnée de l’histoire et abandonné l’idée, pourtant si essentielle, de compromis. Nous n’avons pas encore pleinement accepté que l’histoire puisse nous offrir des remèdes – à condition toutefois de bien vouloir les appliquer. Pour transmettre intacte notre démocratie républicaine aux générations futures, il nous faudra faire mieux.
1. Seth D. Radwell, « American Schism : How the Two Enlightenments Hold the Secret to Healing Our Nation », Greenleaf Book Group Press, 2021, p. 496.
2. NDLR : Le mouvement jacksonien désigne la période de transformation démocratique des États-Unis sous la présidence d’Andrew Jackson (1828-1836), qui se présentait comme le défenseur du peuple contre les élites. Cette ère fut marquée par l’élargissement du droit de vote masculin, l’émergence de partis de masse et une participation accrue des citoyens ordinaires à la vie politique. V. Adam Gopnik et al., « Jacksonian Democracy », United States, Encyclopædia Britannica, 2025.
3. NDLR : « Farmers’ Alliance, un mouvement agrarien américain des années 1870 et 1880, visait à améliorer les conditions économiques des agriculteurs par la création de coopératives et le plaidoyer politique. » V. Pat Brauer, « Farmers’ Alliance », United States History, Encyclopædia Britannica, 2019.
4. Christophe Guilluy, « La France périphérique », Flammarion, 2024, p. 165.
5. NDLR : Après avoir perdu une motion de confiance au Bundestag fin 2024, l’ancien chancelier socialiste allemand, Olaf Scholz, fut contraint de convoquer des élections anticipées. Le 23 février 2025, les conservateurs allemands (CDU/CSU) remportèrent les élections (28,5%), mais ce fut surtout la percée du parti d’extrême droite AfD qui marqua les esprits, avec 20,8% des voix. Ce score, le plus élevé de l’histoire du parti, représente un gain de plus de dix points par rapport à 2021. V. Chloé Lippert, « Élections fédérales allemandes : tout ce qu’il faut savoir sur le scrutin », Toute l’Europe, 6 novembre 2024.
6. Pippa Norris et Ronald Inglehart, « Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism », Cambridge University Press, 2019, p. 564.